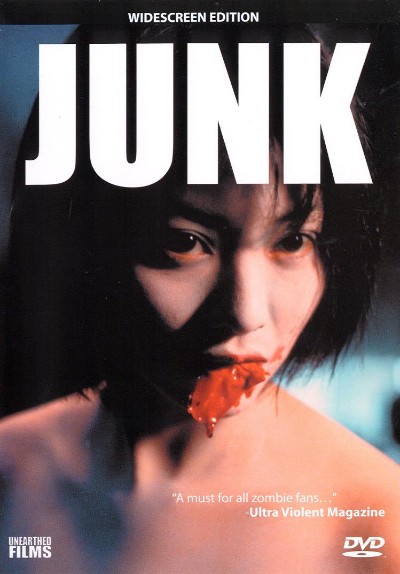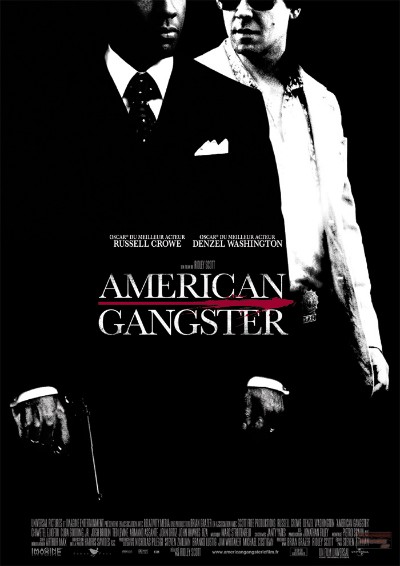Stairway To Heaven est un long métrage amateur tourné en DV sur un simple Canon Xm2. Mais ne vous y fiez pas. Il s'agit d'une production extrêmement maîtrisée et originale n'ayant rien à envier à des oeuvres plus friquées et prestigieuses. Si vous êtes comme moi amateur de films étranges ou que votre culture est centrée sur les jeux vidéos nippons vous y trouverez votre bonheur.
Eric Blame, un journaliste indépendant, enquête sur de mystérieuses disparitions à Toronto, en 1984. Il rencontre dans une cage d'escalier un fantôme qui lui conseille de pousser ses investigations du coté de sa mort. Cette piste le mènera à Heven, un monde étrange et dominé par Rage Cole, un esprit fou.
L'ambiance est calquée sur les phases d'investigations des jeux de type survival horror, avec même quelques références ouvertes : un écran Game over après un erreur du héros, des dialogues par vidéo interposé et une obsession constante pour la recherche d'objets... La photographie, toujours traitée par de nombreux filtres amplifiant le bruit ou salissant les couleurs, rapproche l'ensemble d'un Silent Hill. Clairs-obscurs, blancs saturés et contrejours se multiplient pour un vrai plaisir des yeux. Au niveau purement visuel on s'approche de l'originalité d'un Shinya Tsukamoto (ce qui nous ramène à Haze, également tourné en DV). Bien entendu il n'y a pas encore l'esthétique indicible d'un Vital ou d'un Tokyo Fist, mais l'exploit reste là.
Bien qu'on ne puisse pas s'empêcher de penser à des productions comme Resident Evil, Alone in the Dark et Parasite Eve, les vrais, pas les adaptations cinématographiques, il n'y a pas de véritables monstres dans Stairway To Heaven, juste une ambiance de folie et d'irréalité qui s'installe rapidement et qui s'emplifie continuement. Les seuls apparitions horrifiques sont calquées sur la nouvelle générations de films de fantômes asiatiques avec des spectres aux cheveux longs et à la démarche saccadées, s'approchant de manière discontinue de leurs victimes avec des effets de déformation vidéo. Ringu, The Eye, Dark Water et Ju-on ont été visiblement biens assimilés. Il y a même un peu du Marebito de Takashi Shimizu dans certaines scènes pour un ensemble faisant furieusement penser à Otogiriso de Ten Shimoyama, un autre film que j'adore, lui aussi très inspirée par les jeux et utilisant certaines conventions visuelles vidéoludiques.
Résumer Stairway To Heaven à son ambiance et à son esthétique serait cependant un erreur. Il y a une histoire et son dénouement est formidable. Le seul point obscure concerne certains acteurs, pas très convaincants. Mais à part ça c'est du tout bon, et pas en tant qu'une oeuvre amateur mais en tant que film !
Stairway To Heaven existe en deux versions : celle que j'ai vu, qui dure presque 3 heures, et une version allégée de 1h55. Le rythme et la narration, étant parfaite dans la version longue je vous conseille donc de porter votre choix sur celle là, même si j'ignore tout de l'autre.